La mise en scène de la fausse intelligence
S’il y a un mythe français qui refuse de mourir, c’est bien celui de l’intelligence rhétorique, de l’art du débat. Cet art qui s’épanouit dans un débat télévisé hystérique ou dans une dissertation bien ficelée en trois parties, où l’on pense le monde à coups de citations sorties d’un manuel de prépa. C’est propre, élégant, rassurant. Mais c’est surtout du théâtre.
Car enfin, l’art du débat, cette grande messe médiatique, n’a jamais servi à penser. Il sert à briller, dominer, triompher verbalement. Ce n’est pas une quête de vérité, mais une mise en scène. Le but n’est pas de comprendre le réel, mais d’avoir raison, ou mieux : de faire croire qu’on a raison. Et la dissertation ? C’est le même cirque, mais dans une copie double.
L’art du débat ? Un duel de coqs
Il suffit d’allumer n’importe quelle émission dite « d’idées » pour comprendre : les invités n’écoutent pas, ils attendent leur tour pour réciter leur texte, hurler leur réplique. Chacun campe sur ses positions, feint l’échange, improvise un tango verbal qui ne mène nulle part. C’est un concours de qui aura la dernière formule, la phrase assassine, la référence obscure qui fera taire l’adversaire.
Mais personne n’apprend. Personne n’évolue. Personne ne cherche. Le débat est devenu un sport de chambre d’écho, une masturbation collective de l’égo intellectuel.
La dissertation : l’art du débat avec soi-même
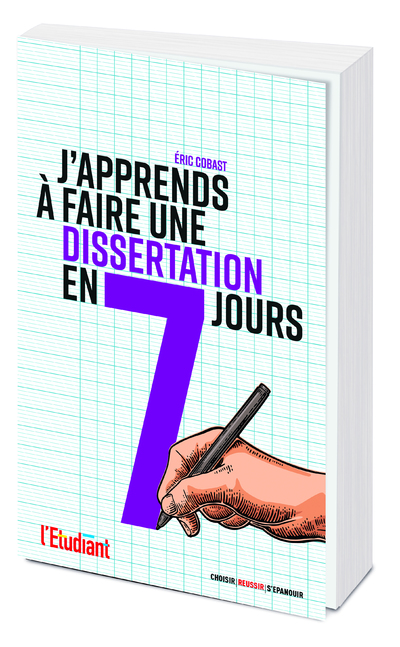
Et que dire de cette idole scolaire qu’est la dissertation ? Ce monument de prétention où l’on apprend dès 15 ans qu’on peut résoudre des questions fondamentales du type « L’homme est-il libre ? » ou « Peut-on tout dire ? » en trois parties et deux transitions.
La dissertation, c’est l’exercice le plus bête du monde, la promesse délirante que l’on peut capturer la complexité du monde dans un plan en trois parties. Il suffit de faire joli : une intro bien arrogante, des citations en latin pour faire sérieux, et surtout, le fameux “plan dialectique” où l’on dit une chose, son contraire, puis on fait une synthèse molle qui ménage la chèvre, le chou, et surtout le correcteur.
Thèse – Antithèse – Foutaise.
La réalité : lente, exigeante, peu spectaculaire
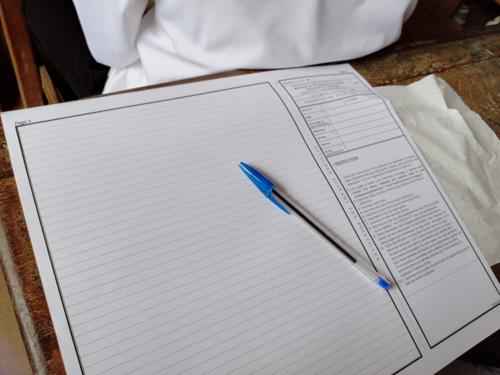
Penser le monde, le vrai, c’est autre chose. Ce n’est pas insérer une citation de Kant entre deux paragraphes sur la liberté. C’est étudier, lire, expérimenter, croiser les données, douter, recommencer, reformuler. Admettre ce que l’on ne sait pas. Passer des années sur un sujet.
C’est échouer, revenir, reconstruire.
L’intelligence, c’est reconnaître que la pensée demande du temps, de la rigueur, de l’humilité. On ne pense pas dans un studio de télévision. On ne pense pas non plus dans une salle de classe où l’on note la capacité à faire semblant d’avoir tout compris.
France : pays où l’on pense à voix haute
Il faut dire que l’intellectualisme français adore ces exercices. Ici, briller c’est parler bien, longtemps, et de tout. Plus c’est flou, plus ça passe pour profond. On confond la parole avec la pensée, le style avec la profondeur, le plan bien mené avec la lucidité.
Pendant ce temps-là, dans d’autres traditions, on se tait, on honore le silence.
Et pendant ce temps, en Asie…
Là-bas, Confucius enseignait dans le silence, Dôgen écrivait des lignes denses comme des blocs de marbre, Lao-Tseu préférait le paradoxe à la démonstration bavarde.
Penser, en Asie, ce n’était pas prouver. C’était vivre, pratiquer, observer longuement. Loin de nos dissertations à trois temps, ils concentraient leur pensée au lieu de l’étaler.
Ils ne cherchaient pas à convaincre par la joute, mais à voir plus clair.
Chez nous, la pensée est un jeu de rôle. En Asie, elle est un chemin.
Retrouvez les différents textes des Nouvelles Mythologies Françaises sur la page consacrée.
